Hisato Higuchi : Netsuobiru Kotoba, Hitoshirezu Ochiru Namida (Ghost Music, 2018)

Première publication de cette quinzaine japonaise organisée au son du grisli à l'occasion de la sortie, ce mois-ci, du livre Micro Japon de Michel Henritzi, cette chronique est celle du premier album d'un top 10 donc Henritzi explique, en préambule, la raison d'être...

Etablir un top 10, c’est sélectionner les disques qui ont été importants pour moi, les disques qui m'ont fait découvrir la musique du Japon, ses particularités, sa force d'invention. Mais il y aurait une forte probabilité que cette liste renferme les noms déjà connus de la musique underground japonaise, ceux que l’on croise depuis trente ans déjà dans les revues spécialisées et les festivals européens et qui m’ont fasciné comme tant d’autres : Taku Sugimoto, Keiji Haino, Kan Mikami, Kazuki Tomokawa, Masayuki Takayanagi, J.A.Saezar, Morita Doji, Masayoshi Urabe, Rinji Fukuoka, Jojo Hiroshige, Yoshihide Otomo… Il est aujourd’hui facile de trouver leurs disques. C’est pourquoi il m'a semblé plus intéressant de choisir ici dix artistes restés dans l'ombre de leurs aînés, dix disques qui m'enchantent, dix disques qui regardent vers le futur de la musique au Japon, sans distinction de genres ou de styles.
On entre dans l'album d'Hisato Higuchi comme Pessoa quittait le monde nocturne des rêves, simplement porté par les sons fragiles de la guitare. Le titre pourrait se traduire par : « Mots perdus, s'endormir », un appel à la rêverie, à l'oubli de soi. Il est seul avec sa guitare électrique à jouer pour les lucioles, la lune qui s'efface à l'aube, les belles endormies. On songe à Loren Connors, comme lui sa guitare est dans le chuchotement, le bégayement, comme lui, il est dans une forme d'éloge à la lenteur, à la fragilité, les notes comme flottant en apesanteur, poussières sonores en suspension. Sept titres dessinés avec légèreté comme des calligraphies subtiles, élégantes sur la feuille blanche de notre écoute. Musicien solitaire dans le retrait des modes et de ses bruits, il joue d'abord en devers de lui-même à l'écoute de ce qui le hante, l'anime, l'émeut, il joue pour la lumière du jour, les nuages filant au loin, des ombres. Comme un blues joué au ralenti, notes délavées s'envolant comme des feuilles emportées par le vent d'automne.

Hisato Higuchi : Netsuobiru Kotoba, Hitoshirezu Ochiru Namida
Ghost Music
Edition : 2018.
Michel Henritzi © Le son du grisli


/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_c69251_1280.gif)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e9fd85_disque-copy.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e48cec_interviews.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_70c886_concerts.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_1d8d17_disques.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_9de6e6_livres-logo.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_45a655_films.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_78eeb7_en-librairie-logo.jpg)
/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_8eca8d_ff-recto.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_8c09bc_sonic-youth.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_ae09ee_screenshot-2024-03-02-at-17-15-20-guil.png)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_76cbf0_couv-grisli.jpg)
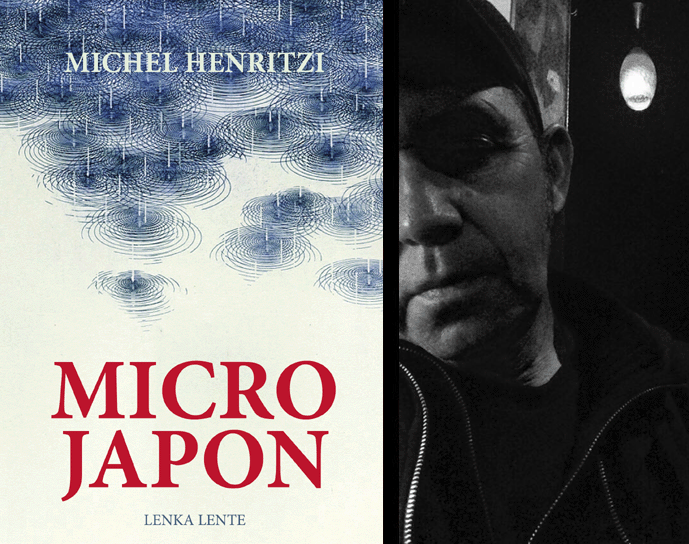
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_a651dd_le-son-du-zombie-effect.jpg)
/image%2F1230432%2F20240504%2Fob_85977a_harutaka-mochizuki.jpg)
/image%2F1230432%2F20240425%2Fob_5613a4_mal-waldron-steve-lacy.jpg)
/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_b405d2_r-27241350-1685506963-5286.jpg)
/image%2F1230432%2F20240404%2Fob_3ba4d0_grisli-mary-chain.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_24ec21_20-guitare-jazz.jpg)