Joan Rothfuss : Topless Cellist. The Improbable Life of Charlotte Moorman (The MIT Press, 2014)
C’est un curieux parcours musical que celui de Charlotte Moorman (1933-1991). D’un des surnoms qu’on lui donna, Joan Rothfuss a fait le titre d’un livre : Topless Cellist. En préambule de l’épaisse biographie, l’auteur avoue que si son sujet est Moorman, on y trouvera aussi un peu d’elle-même ; et puis, que si rien de Moorman ne lui échappe, la Moorman dont elle fait le portrait sur plus de quatre-cent pages ne devra pas forcément être prise pour la « véritable » Moorman.
C’est donc avec élégance que Rothfuss entame son affaire chronologique, qui nous en apprend sur ce qu’on ne pensait n’être que la simple femme-instrument de Nam June Paik. Or… A partir de 10 ans : musique classique obligatoire ; à l’âge de 25 : de musique classique, plus jamais. Au classique, opposer l’original ou l’excentrique : Charlotte Moorman amènera la musique expérimentale (« the newest and most exciting music of our time ») à un public qui est loin de l’être.
Introduite à le « new music » par Kenji Kobayashi, amatrice de Stockhausen, Brown, Cage…, Moorman oublie d’être musicienne pour organiser des « événements » qui connaîtront un certain succès : c’est, en 1961, Works by Yoko Ono ; ensuite, ce seront Cage, Brown, Lucier, Feldman, Corner, Goldstein… qu’elle permettra de faire entendre. Stockhausen jouant les entremetteurs, Moorman et Nam June Paik se rencontrent en 1964 : l’artiste rêve alors pour son « action music » d’une strip-teaseuse sonore. Après Alison Knowles, Moorman s’y colle – lorsqu’elle joua Giuseppe Chiari, un journaliste ne parla-t-il pas de « violoncelle de Lady Chatterley » ?
En marge de Fluxus, Charlotte Moorman – que George Maciunas tenait pour rivale – et Nam Jun Paik composent un personnage ambigu, faisant fi d’anciennes conventions pour mieux en instaurer de nouvelles. Le 12 novembre 1969, la voici interprétant John Cage à la télévision (Mike Douglas Show). Si le compositeur ne saluera pas la performance, il profitera un peu de la publicité qu’elle lui fait. C’est là toute l’ambiguïté de la position de Moorman : actrice et promotrice, vulgarisatrice et vigie, guignol et expérimentatrice : quand certains l’accusent de kitsch, d’autres parlent d’avant-garde. L’histoire est toujours la même, et toujours passionnante : les nouveaux dogmes s’opposent aux anciens, les expérimentateurs « dissidents » courent après les cachets (même publics), les novateurs qui se ressemblent se tirent dans les pattes… Et, à la fin, tout est détaillé en biographies.
Joan Rothfuss : Topless Cellist. The Improbable Life of Charlotte Moorman (The MIT Press)
Edition : 2014.
Livre (anglais) : Topless Cellist. The Improbable Life of Charlotte Moorman
Guillaume Belhomme © Le son du grisli

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_c69251_1280.gif)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e9fd85_disque-copy.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e48cec_interviews.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_70c886_concerts.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_1d8d17_disques.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_9de6e6_livres-logo.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_45a655_films.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_78eeb7_en-librairie-logo.jpg)
/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_8eca8d_ff-recto.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_8c09bc_sonic-youth.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_ae09ee_screenshot-2024-03-02-at-17-15-20-guil.png)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_76cbf0_couv-grisli.jpg)
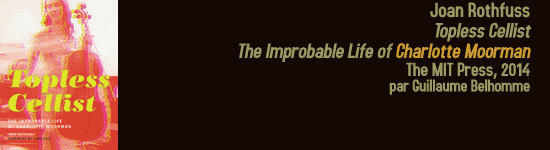
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_a651dd_le-son-du-zombie-effect.jpg)
/image%2F1230432%2F20240516%2Fob_32a0e4_9783969001202-1.jpg)
/image%2F1230432%2F20240504%2Fob_85977a_harutaka-mochizuki.jpg)
/image%2F1230432%2F20240425%2Fob_5613a4_mal-waldron-steve-lacy.jpg)
/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_b405d2_r-27241350-1685506963-5286.jpg)
/image%2F1230432%2F20240404%2Fob_3ba4d0_grisli-mary-chain.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_24ec21_20-guitare-jazz.jpg)