Annette Peacock : I Belong to a World That’s Destroying Itself (Ironic, 2014)
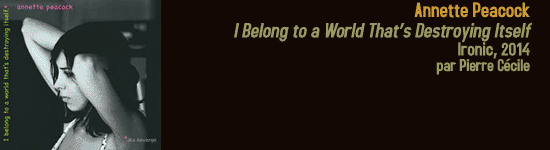
Puisque toute réédition (ou presque) mérite une explication, voilà pour I Belong to a World That’s Destroying Itself : c’est en fait Revenge, qui était sorti au début des années 1970 sous le nom du Bley-Peacock Synthesizer Show (+/- 1969) & qu’il faut désormais considérer comme le premier album solo d’Annette Peacock (non, ce n’est plus I’m the One) puisque Paul Bley n’y apparaît que sur 3 titres et que 8 - 3 = 5 et que 5 c’est suffisant pour un solo. Trêve de précisions, ajoutons qu’on aura pris soin d’agrémenter Revenge de deux morceaux supplémentaires (Flashbacks et Anytime with You).
Ce qu’il y a d’étonnant dans I Belong to a World That’s Destroying Itself (qui est aussi le titre du troisième morceau) c’est qu’il y est presque plus question de voix (celle d’Annette, trafiquée, modifiée…) que de synthétiseurs et d’expés postjazz (en plus de Paul Bley, ont participé à l’enregistrement Gary Peacock, Laurence Cook, Perry Robinson ou Mark Whitecage). Un album de chansons un peu spéciales, il faut bien le reconnaître, parce qu’il racole (mai dans le bon sens du terme = stylistiquement ou genriquement parlant, du côté des protopunk / punkofunk / funkoblues / bluesypop / poprélofi…) même si pas toujours sur le bon trottoir.
Enfin, oui, si le son est un peu sale, c’est normal. Et d’ailleurs ça ajoute aux charmes de la chose qui ne nous vient pas d’une autre époque mais d’une autre planète. Une planète qu’accosteront bientôt (c’est du futur régressif) Soft Machine, Carla Bley ou même (quoi ? qui ?) Astrud Gilberto. De quoi quand même intriguer, et faire à Revenge Nouvelle Formule une belle place dans sa discothèque.
Annette Peacock : I Belong to a World That’s Destroying Itself (Ironic)
Enregistrement : 1968-1969. Ediiton (sous le nom de Revenge) : 1971. Réédition : 2014.
CD / LP : 01/ A Loss or Consciousness 02/ The Cynic 03/ I Belong to a World That’s Destroying Itself 04/ Climbing Aspirations 05/ I’m the One 06/ Joy 07/ Daddy’s Boat (A Lullaby) 08/ Dreams (If Time Weren’t)
Pierre Cécile © Le son du grisli

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_c69251_1280.gif)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e9fd85_disque-copy.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e48cec_interviews.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_70c886_concerts.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_1d8d17_disques.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_9de6e6_livres-logo.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_45a655_films.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_78eeb7_en-librairie-logo.jpg)
/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_8eca8d_ff-recto.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_8c09bc_sonic-youth.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_ae09ee_screenshot-2024-03-02-at-17-15-20-guil.png)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_76cbf0_couv-grisli.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_a651dd_le-son-du-zombie-effect.jpg)
/image%2F1230432%2F20240504%2Fob_85977a_harutaka-mochizuki.jpg)
/image%2F1230432%2F20240425%2Fob_5613a4_mal-waldron-steve-lacy.jpg)
/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_b405d2_r-27241350-1685506963-5286.jpg)
/image%2F1230432%2F20240404%2Fob_3ba4d0_grisli-mary-chain.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_24ec21_20-guitare-jazz.jpg)