Sven-Åke Johansson : The 80's Selected Concerts (SÅJ, 2014)
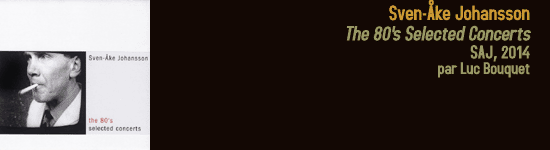
Veillant à la bonne garde et à la restauration de précieux documents archéologiques, de bienveillants ingénieurs du son (ici Christian Fänghaus ou les musiciens eux-mêmes) ont su documenter Sven-Åke Johansson tout au long des eighties. Ainsi :
Le 6 septembre 1990 à Berlin, SÅJ, Wolfgang Fuchs et Mats Gustafsson se répondaient du tac au tac et naissait une utopique fanfare. Clarinettiste et saxophoniste faisaient concours de babillages. Les prises de becs (mémorables !) ne se calculaient plus. L’accordéoniste et le clarinettiste sectionnaient l’horizon. Wolgang Fuchs jouait au crapahuteur chevronné. Sven-Åke Johansson devenait prolixe et inspiré-inspirant. Mats Gustafsson, tout juste la trentaine, ne jouait pas encore au fier-à-bras (depuis…). Précieux document que celui-ci.
A Berlin, un jour oublié de l’an (19)85 un pianiste et un percussionniste combattaient la routine. L’un faisait se télescoper ses claviers acoustique et électronique, débordait de tous côtés tandis que l’autre, émerveillé, frappait et grattait les surfaces passant à sa portée. Instables et fiers de l’âtre, Richard Teitelbaum et Svan-Åke Johansson jouaient à se désarticuler l’un l’autre. Zappant d’une cime à l’autre, parcourant la caverne aux sombres réverbérations, crochetant quelques virages brusques, ils perçaient l’insondable et y prenaient plaisir. Et au mitan de ce trouble magma, le batteur prenait le temps de « friser » en grande vitesse (et haute sensibilité) renforçant ainsi son statut de percutant hors-norme(s).
A Berlin, le 18 mars 1991, ils étaient cinq teutons (Günter Christmann, Wolfgang Fuchs, Torsten Müller, Alex von Schlippenbach, Tristan Honsinger) et un teuton d’adoption (Sven-Åke Johansson) à croiser leur(s) science(s). Il y avait de faux mouvements de jazz, des souffleurs sans états d’âme, un violoncelliste imposait des lignes franches, le pianiste dévastait son clavier (normal : AvS !), on investissait le centre et on ne le quittait pas, violoncelle et piano s’isolaient pour mieux s’agripper, on décrochait des tensions-détentes… Et si n’étaient ces shunts systématiques, on classerait cet enregistrement parmi les plus évidentes références de la fourmilière improvisée.
A Umeå, en novembre 1989, on retenait les cymbales frémissantes du leader, le fin caquetage du sopranino de Wolfgang Fuchs, le trombone-poulailler de Günter Christmann, les crispations d’un violoncelle extravagant. Extravagant, ce cher Tristan Honsinger (qui d’autre ?), et la plupart du temps lanceur et guide d’alertes toujours soutenues par ses trois amis. Risque de décomposition, remous grandissants, souci de ne jamais récidiver, stratigraphie contrariée, voix sans assise, césures permanentes, disgracieux babillages, décapant duo violoncelle-accordéon, jungle déphasée : soit l’art de se rendre profondément ouvert à l’autre.
Au Dunois parisien en 1982, la guitare d’acier d’Hans Reichel réveillait les morts, un flipper passait par là, l’essaim Rüdiger Carl piquait à tout-va, Steve Beresford encanaillait un vieux standard, un cabaret improbable s’installait, la samba était d’épouvante et tous jouaient aux sales gosses (le batteur-accordéoniste semblait y prendre plaisir). A la fin du voyage, l’évidence s’imposait : le désordre avait trouvé à qui parler.
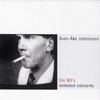
Sven-Åke Johansson : The 80’s Selected Concerts
SÅJ
Enregistrement : 1982-1991. Edition : 2014.
5 CD : Rimski / Erkelenzdamm / Splittersonata / Umeå / BBBQ Chinese Music
Luc Bouquet © Le son du grisli

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_c69251_1280.gif)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e9fd85_disque-copy.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e48cec_interviews.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_70c886_concerts.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_1d8d17_disques.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_9de6e6_livres-logo.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_45a655_films.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_78eeb7_en-librairie-logo.jpg)
/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_8eca8d_ff-recto.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_8c09bc_sonic-youth.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_ae09ee_screenshot-2024-03-02-at-17-15-20-guil.png)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_76cbf0_couv-grisli.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_a651dd_le-son-du-zombie-effect.jpg)
/image%2F1230432%2F20240425%2Fob_5613a4_mal-waldron-steve-lacy.jpg)
/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_b405d2_r-27241350-1685506963-5286.jpg)
/image%2F1230432%2F20240404%2Fob_3ba4d0_grisli-mary-chain.jpg)
/image%2F1230432%2F20240304%2Fob_1fabd3_screenshot-2024-03-04-at-17-17-17-guy.png)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_24ec21_20-guitare-jazz.jpg)