Interview de Jac Berrocal
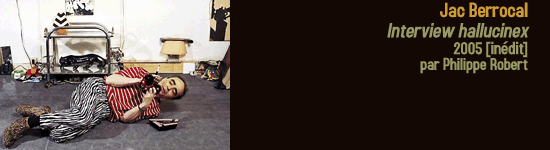
Jamais là où on l'attend le Berrocal. Avec pour preuve, alors qu'il fut un temps où la presse de jazz hexagonale le couvrait de lauriers, sa présence ô combien symbolique dans le Dictionnaire du rock, juste avant Chuck Berry ! Ses influences représentent à elles-seules un invraisemblable kaléidoscope, en phase avec l'envoûtant bric-à-brac qu'est sa discographie, faite de fulgurances qui ne sauraient s'étiqueter. Jazz, impro, no wave, indus : rien ne lui aura échappé. Avec lui, chez lui, dans la pénombre d'une fin d'après-midi automnale, dans ce salon où passèrent Jon Hassell et Vince Taylor, un micro Elvis à portée de main, et au milieu d'ex-voto, de gisants et d'icônes, ces mots rares d'un très GRAND ayant fait l'acteur jusque chez Mocky…
![]()
Quels ont été tes premiers chocs musicaux, ceux qui t’ont initié ? Voyons voir… Lorsque j’étais enfant, oui c’est bien ça, enfant, premier choc, dans une clairière des Charentes, avec le passage d’un autorail rouge et beige tout-au-dessus des grands arbres… L’année de mes huit ans, j’ai aussi été ébloui par les cuivres éclairés de bleu de l’orchestre de Fred Adison se produisant sous un chapiteau de cirque… J’ai ressenti la même chose sur la scène du Châtelet, avec Georges Guétary entouré d’une cinquantaine de girls dans La Rose de Noël… Quoi encore ? Les Petits chanteurs de l’Etoile, avec qui, dès 1956, j’ai appris des motets de la Renaissance. Et puis les orgues, toutes les grandes orgues… Et, à la radio, par-dessus la voix saccadée du speaker, les vrombissements du bolide de Juan Manuel Fangio. Tout ceci mixé avec les accordéons d’André Verchuren et Marcel Azzola, et le son du film Un Condamné à mort s’est échappé de Robert Bresson. En 1963 j’ai assisté à tous les concerts de Duke Ellington, subjugué par son élégance. A la même époque j’entrais par effraction dans le combo de Mick Drot : à la troisième chanson outrageusement yaourt-rock, croyant à une syncope, les pompiers refermaient le rideau rouge sur moi, tandis que backstage, craignant pour ma santé, trois jeunes filles se précipitaient – ma mère était verte de honte… Au même moment, sur Europe 1, Ornette Coleman et Don Cherry jouaient Lonely Woman : je suis plombé !
Parmi ce qui se fait aujourd’hui, qu’écoutes-tu ? Juste à côté de Louis Armstrong, Zarah Leander, Gerry Mulligan, Suzy Solidor, Sonic Youth, Albert Ayler, Pierre Henry pour la musique du film L’Homme à la caméra, eh bien j’écoute Hélène Grimaud, dans le Piano concerto n° 2 de Rachmaninov, car cette grâce me permet d’écrire. Je suis également très fan du pianiste Samson François dont je me soûle régulièrement. Idem de la B.O. du film Downtown 81 sur Jean-Michel Basquiat, parce que cette scène no wave new-yorkaise de la fin des seventies, je la trouve très forte, riche… FUN, BABY ! Et puis, DANS LE NOIR TOTAL, sous climatisation réglée à 16°, j’aime écouter Marylin Manson, ses atmosphères lourdes, lancinantes et totalement funèbres.
Ton parcours est singulier. Qu’est-ce qui t’a poussé à toutes les rencontres qui l’ont jalonné ? Depuis fort longtemps sujet à de fréquents troubles neurasthéniques, 24 heures sur 24, je suis en lisière d’anémie : IL FAUT DONC QUE JE BOUGE ! Si une manière d’envisager la musique m’ennuie, je dois changer de cap : c’est une question de survie. Si quelque chose doit me faire entrer en transe : je fonce ! Je pense par exemple au groupe MKB dont j’adore le traitement guitares / machines sur textes de F.J. Ossang : NOISE’N’ROLL TRANCHANT ! Je pense à une douche de trompette, en suspension autour des poésies de Jacques Doyen, TERRIBLEMENT BOULEVERSANT… Paradoxalement je dirais que l’excentricité ne me convient pas. Une fusion réussie, c’est rare, simple et totalement mystérieux… Lors d’une répétition chez Yvette Horner, je me suis ainsi trouvé à hurler un cantique criminel et gothique sur fond de batterie métallique : TOUTE CHOSE EST POSSIBLE, MÊME UNE RESTAURATION MONARCHIQUE !
Dans quelles circonstances as-tu rencontré Vince Taylor avec qui tu as enregistré le mythique Rock’n’Roll Station, repris par Nurse With Wound ? C’était tout bêtement chez des amis, au début des seventies. Vince était comme un OVNI allant et venant avec une souplesse de félin : un voyant et un séducteur au regard faisant mouche. C’était pile l’année, où, à Londres, à la station Tottenham Court Road précisément, il avait désigné à Bowie, sur une carte d’état-major, l’emplacement secret des caches d’armes que les extra-terrestres avaient fixé pour envahir l’Europe… Vince Taylor a incarné le rock à un point inimaginable de folies sensuelles et scéniques. Si certains, depuis, ont élevé le rock comme un art, LUI SEUL EN A FAIT UNE MESSE IMPREVISIBLE ET TROUBLANTE. Alors, lorsque l’idée de Rock’n’Roll Station m’est venue, son image s’est imposée immédiatement, et l’enregistrement fut bouclé en une heure. Rock’n’Roll Station, c’est une chose qui m’a complètement échappée ; un geste rapide que j’ai mis vingt ans à chanter sur scène.
Peu de temps après, tu as rencontré James Chance avec qui tu as également enregistré.Ah oui… Baltimore, cette étrange factory par des températures en-dessous des normales saisonnières ; et ce taux d’insécurité croissant après 9 heures du soir ! L’enregistrement des Freezing Sessions avec James Chance, Ron Anderson, Mick Evans, Jason Willett, et deux canards dans l’évier : c’était vraiment THE TRASH WAY OF LIFE ! Après avoir mis en boîte un standard de Billie Holiday et rejoué Satan Dance de Giuseppi Logan, nous allions nous réchauffer, en fin de soirée, dans un restaurant où des étudiants fêtaient Mozart. On ne manquait jamais d’y évoquer Roland Kirk. Nous regardions des films d’Ed Wood… Je me souviens d’un truc délirant des Cramps, pour les enfants, tourné dans un hôpital psychiatrique. Puis, micros au ras du plancher, nous changions les paroles de I Wanna Be Your Dog d’Iggy : le 25 cm Flash! résume bien la situation.
Le milieu du jazz en France, les musique dites improvisées, c’est-à-dire aussi ceux qui ont relayé jusqu’à un certain point ton travail : eh bien, finalement, ces mileux, t’y es-tu jamais reconnu ? En ce qui concerne « les musiques dites improvisées », elles ont, en quelque vingt ans, dévié d’une spontanéité irreproductible dans une théatralisation joyeuse de l’extrême, avant qu’on n’y voie plus que des musiciens brillants aux balises consanguines, vendant leurs concerts la tête dans le sac, et le public avec. JE NE PENSE PAS, ACTUELLEMENT, QUE L’ON PUISSE ASSISTER, SUR UNE SCENE COUVERTE DE SABLE ET DE PAROIS FRIGORIFIQUES, A UN CONCERTO POUR PIANO, CAISSE DE BIERE ET MOBYLETTES JAILLISSANTES, PENDANT QU’UN GUITARISTE S’AFFAIRERAIT AVEC DES LEGUMES. Le Sens’ Music Meeting des années 1970 fut l’apothéose de ces manifestations. Le milieu musical trembla un moment, car ce qui choquait, c’était d’y voir en action de sacrés tempérament d’artistes, doublés d’un égal talent pour l’autodestruction : soit une autre manière d’envisager la musique…
Aurais-tu aimé jouir d’une reconnaissance plus large que celle associée à ton statut, si tu me permets l’expression, d’artiste culte ? Tu sais, je jouis déjà, et ma reconnaissance est encore plus large que mon culte ! (Rires) Mais pour cela j’ai UN SECRET : bouger sans cesse afin de n’être pas repéré.
Cela ne t’embête donc pas que d’autres, moins doués, aient tiré les marrons du feu à ta place ? Question un peu stupide, j’en conviens ! Pour paraphraser les propos de Simon de Montfort en 1209, disons que Dieu reconnaîtra les siens !
Pour finir, avec qui rêverais-tu d’enregistrer ?J’aurais fortement aimé participer à l’album Tilt de Scott Walker : une symphonie étrange où l’on perd pied sur des perles baroques d’un autre monde. Et puis, cette grâce de haute-contre improbable, au bord du gouffre… J’en frémis.
Jac Berrocal, propos recueillis en 2005 (ou pas loin).
Philippe Robert © Le son du grisli
![]()

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_c69251_1280.gif)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e9fd85_disque-copy.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e48cec_interviews.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_70c886_concerts.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_1d8d17_disques.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_9de6e6_livres-logo.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_45a655_films.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_78eeb7_en-librairie-logo.jpg)
/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_8eca8d_ff-recto.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_8c09bc_sonic-youth.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_ae09ee_screenshot-2024-03-02-at-17-15-20-guil.png)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_76cbf0_couv-grisli.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F89%2F30%2F335931%2F133238819_o.gif)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F16%2F90%2F335931%2F133036234_o.gif)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F54%2F58%2F335931%2F132648254_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F99%2F08%2F335931%2F132535197_o.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_a651dd_le-son-du-zombie-effect.jpg)
/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_b405d2_r-27241350-1685506963-5286.jpg)
/image%2F1230432%2F20240404%2Fob_3ba4d0_grisli-mary-chain.jpg)
/image%2F1230432%2F20240323%2Fob_e58071_20240323-184328.jpg)
/image%2F1230432%2F20240304%2Fob_1fabd3_screenshot-2024-03-04-at-17-17-17-guy.png)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_24ec21_20-guitare-jazz.jpg)