Interview de Pierre-Yves Macé
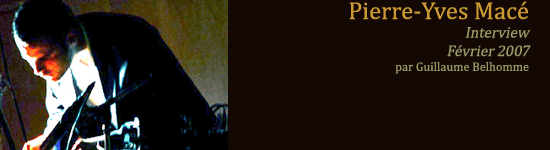
Après avoir enregistré pour le compte des labels Tzadik et Sub Rosa, Pierre-Yves Macé publiait en 2006 sur le label Orkhêstra International son troisième album: Crash_test II. Occasion de revenir sur le parcours d'un compositeur singulier, et d'en éclaircir les intentions esthétiques du jour.
Quelle a été ton initiation musicale ? La musique est restée très longtemps hors de mon univers, et ne m’apparaît que dans deux souvenirs d’enfance : la collection de vinyls de mes parents (notamment un grand coffret qui devait, il me semble, contenir les symphonies de Beethoven) que je ne me lassais pas de contempler et de toucher sans la relier à une expérience auditive. Autre souvenir, très concret également : un temps, qui m’a paru incroyablement long, passé sur le piano des voisins, à essayer de “faire sonner” cet étrange instrument. Puis, vers l’adolescence, mon grand frère qui était alors batteur et composait des chansons m’a fait découvrir ce qui allait devenir mes musiques fétiches (essentiellement du rock 70’s) ; et très rapidement, j’ai eu envie de faire mes propres compositions. Je me suis alors familiarisé avec les machines de l’époque (synthétiseurs, boîtes à rythme et séquenceur sur Atari). Ce n’est que plus tard, vers l’âge de 16 ans, que j’ai étudié le piano et les percussions classiques. Mon approche de la composition a été vraiment déterminée par ce premier rapport, totalement empirique, à la musique, et orientée par ma curiosité en matière d’écoute de musiques différentes, expérimentales, libres, bien plus que par les quelques stages ou ateliers de composition auxquels j’ai pu assister.
Quelles ont été tes premières interrogations en tant que compositeur ? Disons que j’ai essayé de trouver une place qui me soit propre, en tenant compte au maximum de mes goûts personnels et en me départant au maximum de la mesquinerie normative qui règne dans l’enseignement classique de la musique. Mes premières interrogations ont porté sur le rapport entre l’instrumental et l’électronique, deux domaines qui m’intéressaient tout autant, et que j’ai cherché à faire se rejoindre d’une façon qui me semblait singulière, ou en tout cas, qui convenait à ce que j’avais envie d’entendre. Je fantasmais une espèce de croisement entre plusieurs choses que j’écoutais beaucoup : le rock expérimental, la musique ambient, la musique contemporaine répétitive… Croisement qui existait bien effectivement, mais pas exactement comme je le souhaitais.
Peux tu nous présenter chacun de tes enregistrements ? Faux-Jumeaux, paru sur Tzadik, documente en quelque sorte mes premières compositions présentables (j’ai écrit la pièce-titre à l’âge de 19 ans, ce qui explique que j’aie quelque mal à la réécouter aujourd’hui !). Il s’agit de compositions tirant parti du studio et des techniques de production, une espèce de musique concrète réalisée avec des instruments classiques dans une esthétique qui lorgnerait plutôt du côté du néo-tonal minimaliste, empruntant les harmonies de la musique française du début du XXe, certaines tournures de la musique anglo-américaine de la fin du même siècle — j’étais alors très fan de Gavin Bryars, Steve Reich, Lou Harrison — et une certaine quiétude issue de la musique ambient de Brian Eno et Harold Budd. J’ai essayé d’y articuler le statisme de l’objet musical ambient avec le souci plus classique du discours linéaire, en provoquant des enchaînements de stases par rupture en cut au lieu de procéder par évolutions lentes, comme cela se fait habituellement. La composition en “montage” Le sentiment de la nature aux Buttes-Chaumont en témoigne. Dans chaque morceau le sample intervient toujours comme le “double” (d’où le titre) d’une ou plusieurs parties instrumentales intervenant ailleurs. C’est à ce jour mon seul disque entièrement pensé pour le studio. Circulations (Sub Rosa, 2005) et Crash_test II (Orkhêstra, 2006) sont tous les deux des versions CD de pièces destinées à l’origine au concert. Pour Circulations, j’ai voulu pousser plus loin le principe du redoublement par le sample de ce qui est joué par l’instrument. J’ai cherché à créer une forme ample (une seule composition de 50 minutes) dans laquelle chaque événement instrumental serait la matrice (potentielle ou actuelle) d’un développement électroacoustique qui lui coexisterait, d’une façon plus ou moins lisible. Pour le dire autrement, (presque) tout ce que joue chacun des 4 instruments (percussion, guitare électrique, harpe, clarinette) apparaît ailleurs (parfois très loin) dans le morceau sous une forme déguisée. Il y a donc tout un jeu de renvoi entre l’instrument et le sample – un jeu brouillé par la complexité et le caractère labyrinthique de l’ensemble, qui mélange des éléments stylistiquement hétérogènes : on y entend aussi bien du post-rock à la This Heat que des parties pour clarinette et vibraphone très écrites ou encore des moments ambient et electronica.
Qu’a Crash_Test en commun avec les enregistrements précédents et qu'est-ce qui le différencie des autres ? Pour commencer, la part des interprètes y est plus grande ; le disque est crédité sous nos deux noms, le mien et celui du quatuor pli. La différence la plus “audible”, c’est qu’on y sent beaucoup moins l’influence du rock et en revanche beaucoup plus celle de la musique dite “expérimentale” américaine: celle de John Cage, bien entendu, mais également celle des moins connus Christian Wolff et surtout Alvin Curran.
Les compositions de ce disque ont d’abord été destinées à être jouées en concert. Comment s’est faite leur adaptation pour le disque ? Je dirais qu’avec le passage au disque, on perd deux choses : en premier lieu on perd les aléas de la performance qui n’est jamais tout à fait la même à chacune de ses occurrences, y compris pour la musique la plus rigoureusement écrite. Pour répondre à cela, nous (les interprètes, le label Orkhêstra, la Fabrique, notre hôte pour la résidence et l’enregistrement, et moi-même) avons choisi de réaliser deux pressages du disque, dans chacun desquels figure une seule des deux interprétations existantes d’Opérations de chance. Ainsi, en achetant le disque (je sais que c’est un peu has been d’acheter des disques, mais en l’occurrence voilà une bonne raison de le faire;), on fait soi-même une “opération de hasard”, puisqu’on choisit sans le savoir — et rien ne permet de le savoir tant que le disque n’est pas décellophané — une version au détriment de l’autre. En second lieu, avec l’enregistrement, on perd également la perception de l’espace, puisque l’ensemble des informations sonores se trouve compacté en deux canaux (une paire stéréo) ; le format 5.1 ne résout pas ce problème, car s’il y a bien plus de canaux, on est très loin de la richesse perceptive d’une écoute “naturelle” des sons du monde, laquelle ne saurait être totalement simulée par un système de diffusion de son enregistré. Ces considérations sont d’une importance capitale pour Crash_test II (et également pour le premier volet Crash_test I, inédit sur disque) puisque lors de la performance, les musiciens sont invités à se déplacer dans l’espace. Le lieu est donc investi comme élément à part entière de l’économie compositionnelle : il est ce qui littéralement absorbe la présence corporelle des interprètes. Cette absorption est rendue visible par la “scénographie” de l’ensemble : la première partie (Tensionnelle intégrité) met conventionnellement les 4 musiciens du quatuor en position frontale ; puis dans la seconde partie (Opérations de chance), chaque musicien ne cesse de se déplacer en des points épars, décrivant un mouvement d’éloignement vers le fond de la salle. Le dernier mouvement, Tensionnelle Intégralité consiste en la diffusion d’une bande magnétique seule contenant une réécriture des sons du même quatuor. Le quatuor enregistré ("faux") prend la place frontale initiale du “vrai” quatuor, lequel intervient néanmoins à la toute fin, mais, resté dans sa position éloignée, il est alors invisible du public. C’est à l’expérience d’une disparition du corps sonore formé par le quatuor à cordes que le public est convié. Que se passe-t-il donc sur disque ? On perd la perception de l’espace global, c’est certain, mais c’est au bénéfice d’autre chose : d’une variabilité des plans et d’une acuité de perception qui sont tout simplement impossibles pendant le concert. Dans Opérations de chance, j’ai activement recouru au mixage pour provoquer des changements de plan, d’échelle, de poids, mettre en valeur des matières, etc. : des problématiques qui sont celles de la musique concrète. À la mobilité du quatuor dans l’espace physique “réel” de la salle de concert s’est substitué son polymorphisme dans l’espace certes plus exigu du plan stéréo, lequel offre néanmoins beaucoup de possibilités.
Avec cet album, tu interroges le hasard et son usage dans l’acte de composition mais aussi d’interprétation. Comment se traduit cette interrogation concrètement ? Est-ce un moyen de rétablir le jeu dans le champ d’une interprétation classique trop rigoureuse ? Oui, disons que les partitions totalement écrites, propres sur elles et rasées de près, dont la musique contemporaine abonde, m’ennuient un peu, en général.Concrètement, il y a plusieurs éléments de hasard à l’œuvre dans Crash_test ii: dans Opérations de chance le jeu des pièces de monnaie (pile ou face) que les musiciens sont invités à renouveler un certain nombre de fois – là on est dans un aléatoire objectif, très simple, à deux termes, avec un probabilisme de type 50 / 50. Pile : le musicien joue de son instrument ; face : il joue du magnétophone à cassette.
Puis il y a une forme d’indétermination qui n’a plus grand chose à voir avec de l’aléatoire, et qui repose sur les choix conscients de l’interprète par rapport à des libertés qui lui sont offertes : le plus souvent, les durées des notes ne sont pas spécifiées, parfois les hauteurs sont libres – et l’interprète doit souvent choisir un motif ou un module au sein d’un “réservoir” de matériel. Entre ces deux extrêmes — l’aléatoire pur et le choix conscient — d’autres indéterminations sont plutôt de l’ordre de l’immotivé : c’est le hasard qu’il y a lorsque tu dois par exemple choisir “au hasard” entre trois verres de whisky absolument identiques lequel est le tien et lesquels ceux de tes convives : tu choisis consciemment, mais de façon arbitraire, dénuée de toute intention particulière (à moins bien sûr que les doses de boisson ne soient pas les mêmes). Dans “opérations de chance”, si le musicien fait face (je veux dire avec sa pièce de monnaie), il joue du magnéto selon une instruction simple : il recale la bande où il veut (quelques secondes d’avance rapide) et appuie sur play. Or, chacune des 4 cassettes contient une distribution de silences et de sons (issus d’enregistrements du quatuor) qui est certes fixée, mais de façon fortuite, ou peu pertinente : je l’ai réalisée “à l’aveugle” en bourrant pro-tools, veillant seulement à ce que les durées ne soient pas les mêmes d’une cassette à l’autre. De la même façon l’interprète choisit le moment où il se cale sur la cassette, mais il n’est pas censé connaître le détail de ce qu’elle contient (avant la performance, les musiciens choisissent une cassette parmi les 4 au hasard, de sorte qu’il n’a jamais de repère). Quand bien même l’interprète connaîtrait dans les grandes lignes la succession des sons, l’évaluation des temps de silence est quant à elle impossible, et met nécessairement tous les interprètes dans un état d’attente ou de protention, de tension vers ce qui va arriver.
Quelle est la différence selon toi entre le hasard intervenant dans l’improvisation, et le hasard intervenant dans l’interprétation d’un thème écrit ? La pratique de l’improvisation me semble tout entière tendue par ce mouvement de protention dont je parle. En tant que compositeur, j’ai une préoccupation exactement inverse : créer une forme, ce qui implique une part de rétention, employer le temps différé et la mémoire objectivée par l’écriture pour rétroagir sur ce qui a été fait.
Cela dit, tout acte de performance, qu’il soit de l’ordre de l’improvisation ou de l’interprétation d’une musique strictement écrite, se déploie toujours dans cette protention : on ne sait jamais ce qui va arriver, si on ne va pas casser une corde, si le public ne va pas commettre un beau scandale (quoique cela ne soit plus guère au goût du jour), ou si le lieu où l’on joue ne va pas capricieusement s’écrouler… Cette part d’incertain, ce sont les “accidents” qui jalonnent nécessairement un déroulement temporel qui ne pourra jamais — et heureusement — recouper totalement la prévision qu’on en a.
En tant que compositeur, les formes musicales que je trouve les plus excitantes sont celles qui sont — consciemment ou non — travaillées de l’intérieur ou fragilisées par la possibilité de l’accident. Ce sont les formes qui nous rappellent tout le temps que tout est possible, qu’un accident est vite arrivé, et qu’il suffit de peu pour que l’ordre apparent se mue en chaos.
Les deux volets de Crash_test ont pour ambition de créer des conditions propices à l’émergence de ces éléments accidentels en tant que tels. Et au fond, c’est bien ça, littéralement, faire un “crash test” : provoquer un accident de façon intentionnelle et expérimentale (au sens scientifique). Cela peut paraître un peu déplacé, mais tout cela doit beaucoup au choc qu’a exercé sur moi l’écoute des derniers disques de Talk Talk et notamment de Laughing Stock, auquel je voue une vénération inconditionnelle. Les propos de Mark Hollis sur la réalisation de ce disque sont clairs : il s’agissait de créer des conditions favorables pour que “cela” (l’accident, l’imprévu) puisse se produire. Au milieu d’heures de sons capturés et accumulés, Hollis dit que ce qui l’intéresse c’est le son du micro heurté par hasard par le musicien (l’accident par excellence). Pourtant nous ne sommes jamais dans de l’improvisation pure, mais tout au contraire, dans une forme très forte, celle de la chanson. Le tour de force de ces Anglais est de parvenir à fragiliser constamment cette forme, et d’une façon ô combien belle et singulière, n’est-ce pas ? (bon, c’est certain, la voix de Hollis n’y est pas pour rien…).
Plus globalement, je suis intéressé par les écritures musicales qui cherchent à se mettre en danger, à subvertir les certitudes sur lesquelles elles s’établissent. Dans Circulations, par exemple, il me semblait important que les moments très écrits du premier mouvement pour percussion soient contrebalancés / mis en danger par l’absence totale d’écriture des moments destroy du mouvement pour guitare, lesquels sont plutôt de l’ordre de l’expression spontanée d’une énergie brute. Impur, la composition de Fred Frith qui vient de sortir sur disque, me semble une remarquable réussite à cet égard ; et ce n’est pas un hasard si, comme Crash_test II, elle joue sur l’espace — sur la coexistence du divers.
Lors de l’enregistrement, tu cherches à déstabiliser les interprètes via l’utilisation d’enregistrements sur bandes… Pourquoi ce moyen là particulièrement ? Disons qu’il me fallait, dans Opérations de chance, préparer le troisième mouvement pour bande seule. Il m’a semblé intéressant que la matière brute des sons de quatuor retravaillé qui le composent apparaisse ailleurs. Diffusés sur des magnétophones cassette cheap avec des haut-parleurs lo-fi, ces sons sont contextualisés, deviennent des événements sonores intégrés à l’espace de jeu ; ils sont également instrumentalisés puisque les musiciens les martyrisent avec une jubilation certaine (que bien entendu je soutiens et partage totalement…) en manipulant leurs petits magnétophones : ils les coupent (en faisant entendre le bruit des touches), en accélèrent la vitesse…
Si les musiciens instrumentalisent ces sons, ils sont en retour quelque peu instrumentalisés par eux, et c’est là qu’on peut rejoindre ce que tu appelles la “déstabilisation” des interprètes. Cela rejoint une des préoccupations de Christian Wolff : créer des conditions qui incitent l’interprète à prendre des décisions qui ne peuvent être prises qu’au moment de la performance (laquelle ne peut donc pas être préparée à l’avance dans son déroulement). Dans Opérations de chance, lorsqu’un musicien fait “pile” et donc joue de son instrument, il doit parfois non plus “agir” mais “réagir” à des événements : s’il entend une impulsion (généralement issue des magnétophones, mais cela peut être autre chose : une pièce de monnaie qui tombe par terre lors d’un pile ou face raté, comme cela arrive dans une des versions), il doit jouer une note tenue, ou au contraire répondre par une autre impulsion… Cela peut le prendre par surprise, interrompre ce qu’il jouait ou encore interférer sur son intention de jeu originale.
Comment s’est fait le choix du quatuor à cordes ? Ce fut la conjonction de deux séries séparées. D’un côté, Bruno Meillier, directeur du festival Musiques Innovatrices et du label Orkhêstra voulait m’inviter à composer une création pour l’édition 2006 du festival. De l’autre, le quatuor Pli, alors en résidence dans le lieu très hospitalier La Fabrique, dirigé par Philippe Chappat, cherchait à travailler avec des compositeurs sur des formes mêlant l’écriture et l’improvisation. Chappat et Meillier étant associés sur la programmation du festival, la rencontre était fatale.
Quelle que soit la forme de l’enregistrement (ici, réussi), peut on être satisfait d’un tel disque au niveau de ses facultés à répondre à des interrogations plus théoriques ? À l’horizon de Crash_test II, il y a toute une littérature, désormais datable et datée (vers les années 50-60) d’œuvres que l’on a pu dire “ouvertes” (en Europe, surtout, en référence à l’ouvrage d’Eco), de partitions indéterminées qui étaient composées afin entre autres de pousser les interprètes classiques vers l’improvisation. Aujourd’hui, on ne compte plus les improvisateurs qui n’ont plus besoin de ce genre de partition, graphique, textuelle ou autre. On est dans une situation exactement inverse : ce sont les improvisateurs qui sont à la recherche de ce genre de répertoire pour contraindre leur jeu. J’ai pu ainsi composer ma première partition graphique, Départition, en 2004, à la demande du guitariste improvisateur Jean-Marc Montera pour l’EIE, l’ensemble d’improvisateurs européens dont il est l’initiateur. Crash_test II s’inscrit dans ce sillage. En effet, la particularité du quatuor Pli est d’être constitué de musiciens aux parcours très hétérogènes, dont le point de conjonction est l’improvisation. Symboliquement, ce renversement implique que la partition n’est plus tant ouverture de possibles dans un champ clos, que clôture des possibles dans un champ infiniment ouvert. Ainsi, à l’inverse de ce qui se passe dans les partitions des années 50-60, j’ai pour ma part une certaine attente / exigence quant au résultat sonore — exigence que j’hérite de ma démarche “concrète”. Je me sers donc paradoxalement de l’indétermination pour atteindre à un but que j’ai déjà déterminé : c’est pour cela que dans Crash_test II, on peut entendre des harmonies tonales, des bribes de mélodies, et des formes clairement articulées, choses qui sont radicalement impossibles dans les partitions expérimentales américaines les plus radicales. Cela implique autre chose : que le travail de composition ne s’arrête pas à l’écriture de la partition, mais déborde largement sur la période des répétitions, où est rendu possible un rapport plus concret à l’écriture, qui affine précisément le résultat musical. Là se situe peut-être le moment réactionnaire de mon travail ; mais comment ne pas être un peu réactionnaire si l’on veut toujours faire de l’art après les avant-gardes, et si l’on estime — c’est mon cas, mais cela pourrait se discuter — que l’art n’a pas encore totalement sapé les fondements qui le rendaient possible ?
Selon toi, la multiplication de l’écoute de Crash_Test amène-t-elle à valider une autre forme d’écriture musicale, le disque fini renfermant aussi solennellement l’œuvre qu’une partition classique ? Si l’enregistrement referme l’œuvre, c’est bien plus radicalement que ne le fait la partition qui, elle, ne fait que donner des instructions. Mais cette fermeture ne me pose pas de réel problème, si elle parvient à rendre sensible la fragilité dont je parlais tout à l’heure. Pour reprendre un exemple qui — tu l’auras remarqué — m’est cher : cela ne me dérange pas que la chanson Myrrhman de Talk Talk (Dieu sait le nombre de fois que je l’ai écoutée…) n’existe que dans la seule version que propose le disque, même si elle comprend une part importante d’improvisation — l’ouverture des possibles est paradoxalement contenue dans l’enregistrement unique. Pour le récepteur, une œuvre ouverte sera toujours perçue comme une œuvre fermée, comme disait un compositeur bien plus sérieux que moi (Nunes, je crois bien). En d’autres termes, une composition de ce genre, si elle est réussie, n’a pas à être validée par l’épuisement de toutes ses réalisations possibles ; en théorie, une seule devrait suffire, même si le choix de celle-ci plutôt qu’une autre ne se départira jamais de son caractère arbitraire.
Pierre Yves-Macé, février 2007.
Guillaume Belhomme © Le son du grisli.

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_c69251_1280.gif)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e9fd85_disque-copy.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e48cec_interviews.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_70c886_concerts.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_1d8d17_disques.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_9de6e6_livres-logo.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_45a655_films.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_78eeb7_en-librairie-logo.jpg)
/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_8eca8d_ff-recto.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_8c09bc_sonic-youth.jpg)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_ae09ee_screenshot-2024-03-02-at-17-15-20-guil.png)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_76cbf0_couv-grisli.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F67%2F55%2F335931%2F131019674_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F54%2F65%2F335931%2F129027233_o.gif)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F68%2F335931%2F128785044_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F16%2F31%2F335931%2F121059923_o.jpg)
/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_a651dd_le-son-du-zombie-effect.jpg)
/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_b405d2_r-27241350-1685506963-5286.jpg)
/image%2F1230432%2F20240404%2Fob_3ba4d0_grisli-mary-chain.jpg)
/image%2F1230432%2F20240323%2Fob_e58071_20240323-184328.jpg)
/image%2F1230432%2F20240304%2Fob_1fabd3_screenshot-2024-03-04-at-17-17-17-guy.png)
/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_24ec21_20-guitare-jazz.jpg)